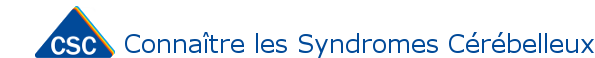Connaître les maladies cérébelleuses
- Questions-réponses (6)
-
> Qu’est-ce qu’un syndrome cérébelleux ?
> Qu’est-ce que le cervelet ? Quel est son rôle ?
> Quelles peuvent être les conséquences d’un syndrome cérébelleux sur les apprentissages de l’enfant ?
> Qu’est-ce qu’un centre de référence ?
> Le livret d’accueil CSC ? C’est une mine d’informations !
> Quelles sont les ataxies cérébelleuses d’origine génétique ?
- Articles scientifiques (5)
-
> Identification d’un syndrome rare : ça change tout !
> Premiers résultats de l’étude Euro-CDG sur la description clinique et biologique des PMM2-CDG
> Compte-rendu de la Conférence internationale sur les paraparésies spastiques et les ataxies 2016
> Ataxies et Paraplégies Spastiques
> La NAF propose un protocole de diagnostic des Ataxies Spinocérébelleuses
- Témoignages et projets (12)
-
> La recherche a besoin de cerveaux !
> « Pour continuer le combat » par Hubert
> Le don de cerveau : dans la pratique, comment cela se passe-t-il ?
> Retours sur la Journée internationale de sensibilisation sur l’ataxie
> Pour mieux comprendre le jargon et ne plus le subir : le stage « Initiation à la biologie moléculaire et aux neurosciences »
> Mieux comprendre le rôle du cervelet dans les apprentissages langagiers et non verbaux
> Découvrez le quotidien de nos jeunes Héros en images !
> Le rôle des causes génétiques dans les maladies rares neurodégénératives en vidéo
> CSC était à la journée inter-filière MetabERN CDG, le vendredi 22 mars 2019
> 3e Journée des Familles et des Associations « Malformations et Maladies Congénitales du Cervelet »
> « Les effets au quotidien des ataxies à déclaration adulte », par Hubert Boeuf

> Inscription à la formation PARENTS-EXPERTS par Brain Team

- Formations scientifiques (5)
-
> Formations ADN « Des clés pour comprendre » : 3 jours de stage qui répondent à toutes vos questions !
> Séminaires Inserm "Fonctions cognitives chez l'enfant" : les clés pour comprendre
> Orphelines… de traitement
> Formation Ketty Schwartz « santé et environnement »
> Formation en ligne « séquençage et tests génétiques » - les mercredi 14 et vendredi 16 avril 2021
Publié le 26-01-2014 - MAJ le 26-01-2014 - Par Pr. Nathalie SETA - 0 commentaire(s)
CDG Syndroms, Recherche clinique, Enfance et adolescence
Premiers résultats de l’étude Euro-CDG sur la description clinique et biologique des PMM2-CDG

Le Professeur Nathalie SETA du laboratoire de biochimie de l’hôpital Bichat a présenté en novembre 2013 lors d’une journée organisée par CSC, les premiers résultats d’une étude réalisée par le réseau de recherche Euro-CDG. L’étude vise à mieux comprendre la variabilité clinique des PMM2-CDG (syndrome CDG1A) afin d’améliorer la stratégie diagnostique, de renforcer les connaissances sur l’évolution de la maladie, de préciser son histoire naturelle et d’étudier les relations entre phénotypes et génotypes.
Le texte ci-après est la retranscription de la présentation du Pr Nathalie SETA lors de la journée du 23 novembre 2013.
Alors que nous connaissons désormais un certain nombre d’enzymes et de gènes impliqués dans le CDG (anomalie congénitale de glycosylation), nous manquons d’informations sur la description clinique des patients.
Alors que nous connaissons désormais un certain nombre d’enzymes et de gènes impliqués dans le CDG (anomalie congénitale de glycosylation), nous manquons d’informations sur la description clinique des patients.
I. Objectifs
Un groupe européen de chercheurs, biologistes et cliniciens a été constitué dans le cadre du programme de coordination de la recherche EuroCDG financé par l’Union européenne. Il a pour objectifs de mieux comprendre la variabilité clinique des PMM2-CDG (ex- CDG 1A) afin d’améliorer la stratégie diagnostique, de renforcer les connaissances sur l’évolution de la maladie, de préciser son histoire naturelle et d’étudier les relations entre phénotypes et génotypes.
Les PMM2-CDG sont ceux qui concernent le plus grand nombre de patients. En l’occurrence, les deux tiers des 194 patients de la cohorte française avec un diagnostic de CDG ont une mutation du gène PMM2.
Les PMM2-CDG sont ceux qui concernent le plus grand nombre de patients. En l’occurrence, les deux tiers des 194 patients de la cohorte française avec un diagnostic de CDG ont une mutation du gène PMM2.
II. Méthode et population d’étude
La première étape consiste à collecter des données, en général rétrospectives : données du génotype et données cliniques recueillies par des questionnaires envoyés aux cliniciens qui prennent en charge les patients concernés. Le recueil des données cliniques requiert beaucoup de temps. Un traitement statistique est ensuite effectué, en vue d’analyser l’ensemble des données.
Sur 105 patients atteints de PMM2-CDG, nous avons obtenu des données pour 95 sujets issus de 78 familles. Jusqu’ici, les études sur des groupes de patients portaient sur 26 sujets au maximum. Ces données cliniques sont encore en cours de traitement, mais nous sommes d’ores et déjà en mesure de décrire la population étudiée selon plusieurs caractéristiques :
Sur 105 patients atteints de PMM2-CDG, nous avons obtenu des données pour 95 sujets issus de 78 familles. Jusqu’ici, les études sur des groupes de patients portaient sur 26 sujets au maximum. Ces données cliniques sont encore en cours de traitement, mais nous sommes d’ores et déjà en mesure de décrire la population étudiée selon plusieurs caractéristiques :
- le lieu de vie (en famille, en famille et en maison spécialisée, en maison spécialisée seulement) ;
- la scolarisation (adaptée ou normale) ;
- la situation professionnelle ;
- le sexe (58 % de garçons et 42 % de filles) ;
- la situation géographique (30 % en Ile-de-France, sans doute du fait de l’errance diagnostique qui conduit à orienter vers le centre de référence, 8 % en Bourgogne, 8 % en Rhône-Alpes) ;
- l’âge (52 % sont nés avant 1997 et 40 % après 2000) ;
- l’âge de diagnostic (en forte diminution depuis les premiers diagnostics au milieu des années 1990) ;
- les circonstances de la demande de dépistage (principalement l’hypotonie, le retard psychomoteur et les syndromes cérébelleux) ;
- l’équipe de suivi (41 % en centre de référence, CHR, CHU ou CHG, 18 % chez le médecin de famille seul) ;
- le profil neurologique (principalement une anomalie du neuro-développement, un syndrome cérébelleux, une ataxie ou une hypotonie axiale) ;
- la rééducation (83,6 % des enfants suivent au moins une rééducation) ;
- la répartition entre les formes neurologiques pures et les formes neurologiques avec des atteintes associées (plus de 33 % des patients ont une forme viscérale, mais la majorité a une forme simplement neurologique. Par ailleurs, les atteintes multi-viscérales se retrouvent uniquement chez les enfants en bas âge).
Cette description clinique basique illustre le manque d’informations, pourtant essentielles pour améliorer la stratégie diagnostique et savoir comment évoluent les enfants.
Qui plus est, une thèse de médecine dirigée par Delphine Héron montre que les patients atteints de PMM2-CDG sortent des circuits médicaux quand ils atteignent l’âge adulte. Il est alors très difficile de les retrouver. Pourtant, leur besoin de suivi est réel.
« Dans l’évolution naturelle des PMM2-CDG, certains patients connaissent des stroke-like épisodes (pseudo-épisodes vasculaires cérébraux). L’étude EuroCDG montre aussi l’importance du traitement de la fièvre lors de ces épisodes, car elle détruit les enzymes qui sont thermolabiles. » Pascale de LONLAY
Professeur Nathalie SETA,
laboratoire de biochimie de l'hôptial Bichat
Complément d'information
Document(s) associé(s)
Article(s) associé(s)

Gilles a écrit
Document très complet et compréhensible qui permet de se projeter et prévoir des solutions pratiques (même si un peu "plombant" quand on n'est qu'au début de la maladie).
Une question concernant la vision : le fait de ne pouvoir lire en temps les panneaux routiers de direction (où figurent de multiples informations, villes par exemple) ou les détails sur une carte (absence de réflexe oculomoteur) n'est pas évoqué. Est-ce un effet lié à la maladie ?
Merci en tout cas !
Sur l'article
« Les effets au quotidien des ataxies à déclaration adulte », par Hubert Boeuf

Sylvia a écrit
Merci pour ces informations précieuses. Super document à lire absolument car très utile. Encore merci ! Sylvia H
Sur l'article
« Les effets au quotidien des ataxies à déclaration adulte », par Hubert Boeuf

fregate a écrit
G tout lu c interressant a savoir tout cela ce cervelet me fait tout cela pieds glacer g tout c une nol 3 moi merci pour ce que vs faite dieu vs le randra amicalement madame gorriez
Sur l'article
« Les effets au quotidien des ataxies à déclaration adulte », par Hubert Boeuf

Claudine70 a écrit
c'est bien d'avoir une vision d'ailleurs !
Sur l'article
La NAF propose un protocole de diagnostic des Ataxies Spinocérébelleuses

CDG Syndroms
L'association CSC a soutenu la Recherche à hauteur de 120 000 euros en 2013 !
Journée d’information sur les syndromes cérébelleux (nov. 2013) : chercheurs, enfants, parents, tous ensemble !
Retranscription de la journée des familles CSC 2017
Recherche clinique
Chercheurs à vos stylos : CSC publie deux appels d'offre pour financer la Recherche à hauteur de 75 000 euros sur 2017/2018
Le livret d’accueil CSC ? C’est une mine d’informations !
Appel d’offre 2022 : 80 000 euros pour soutenir la recherche !
Enfance et adolescence
Le judo pour un enfant cérébelleux : une idée saugrenue ?
Un enfant atteint d’un syndrome cérébelleux peut être scolarisé en milieu ordinaire, mais pas à tout prix
Le Comité Médical Pédiatrique